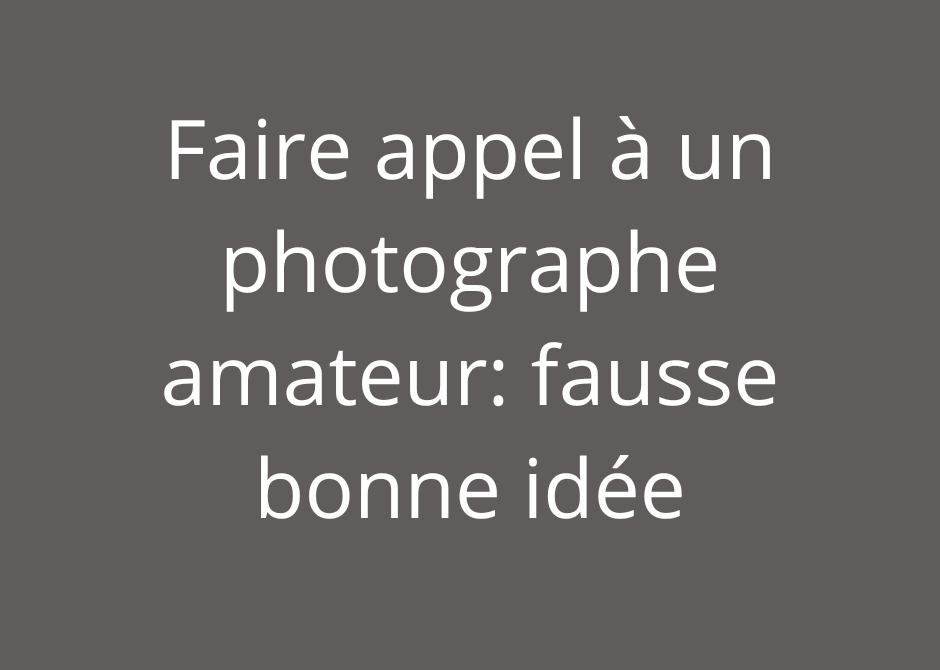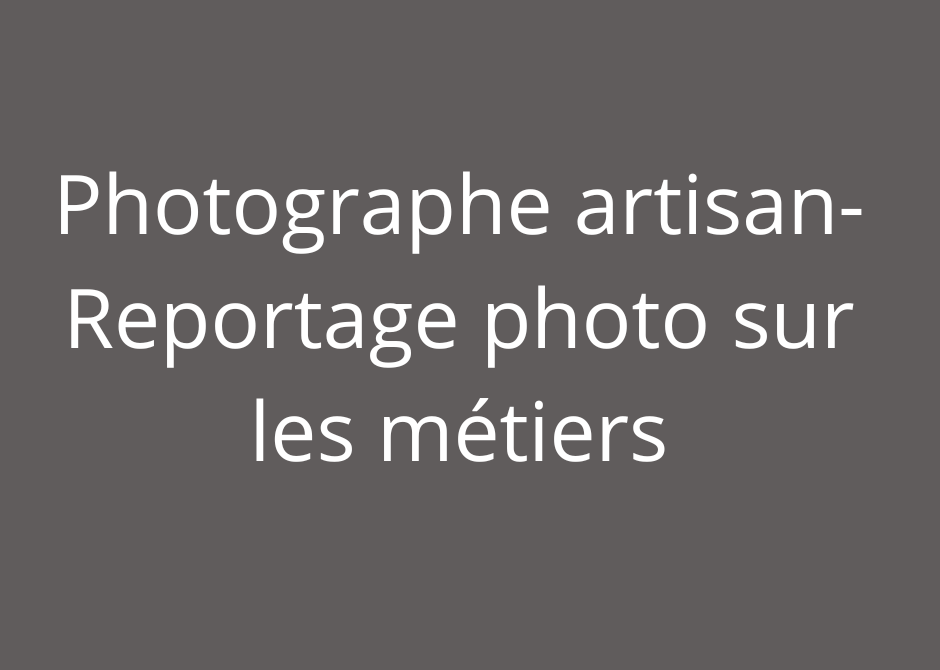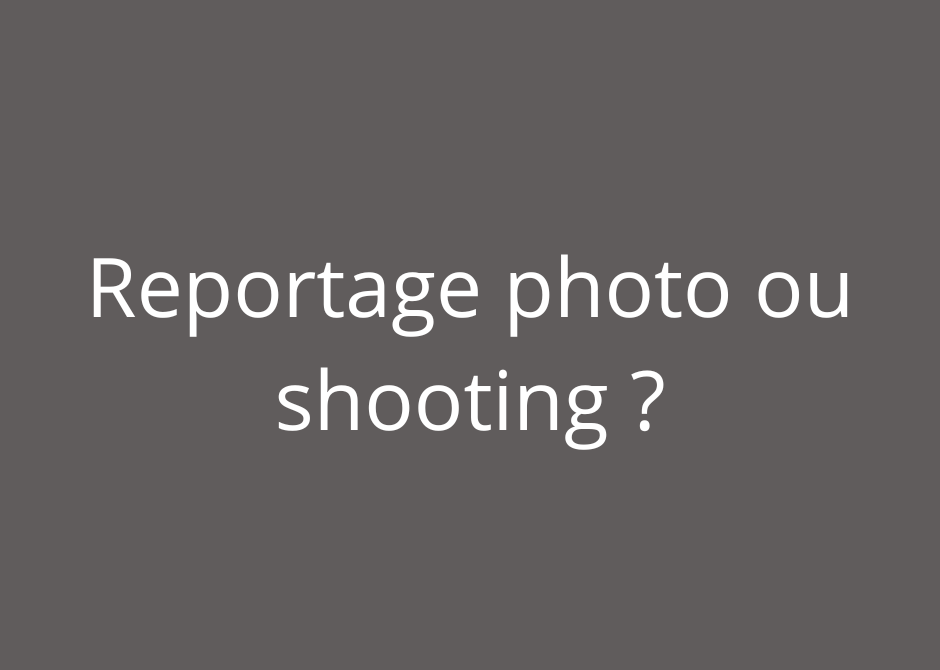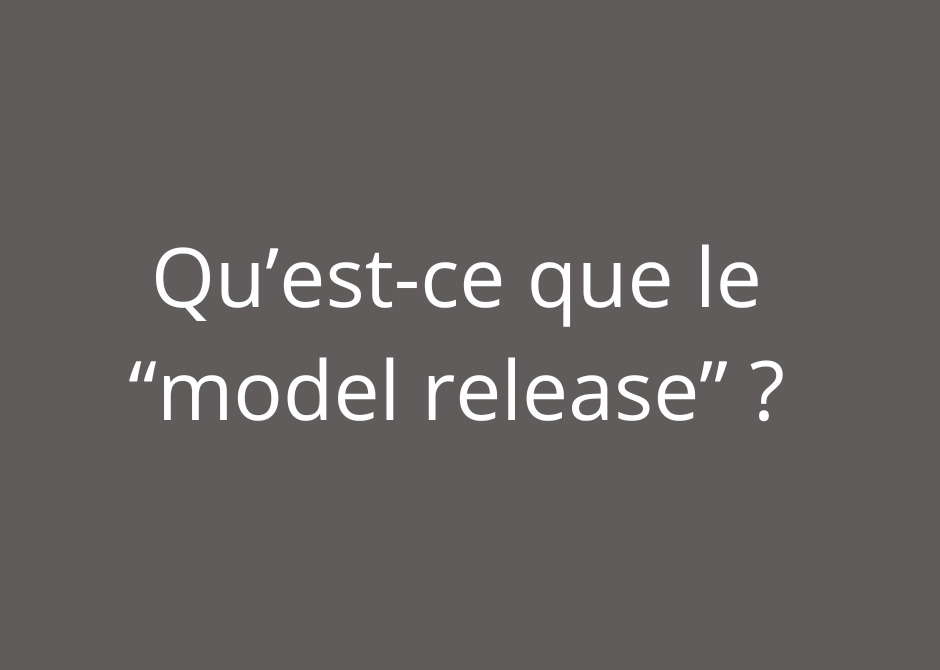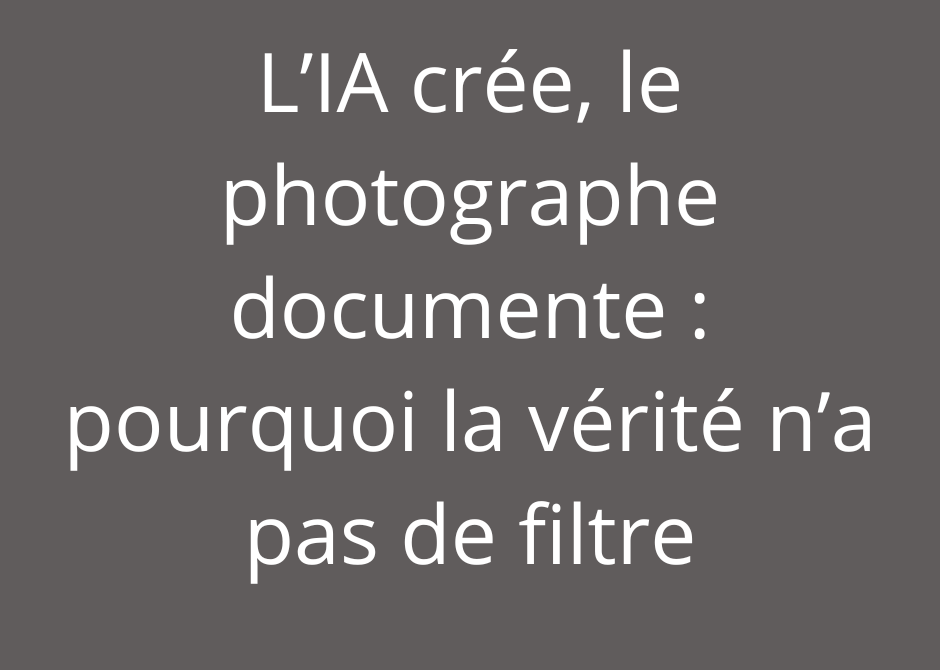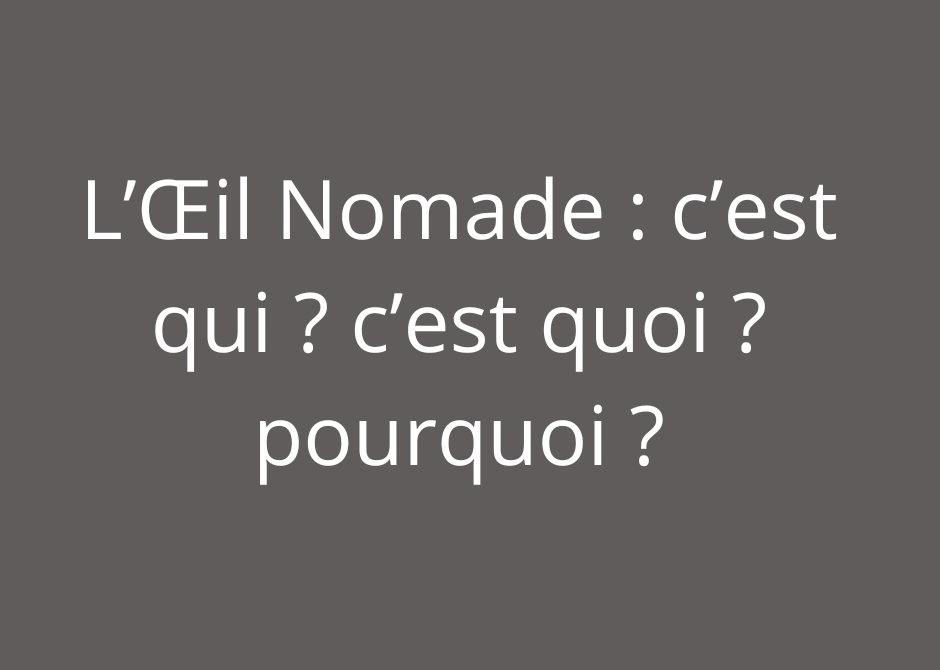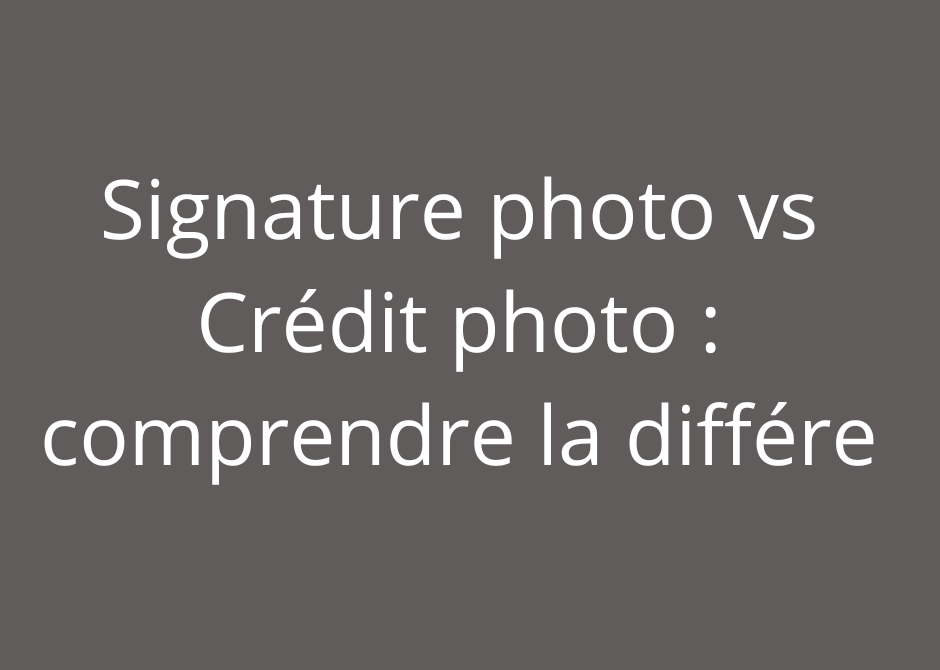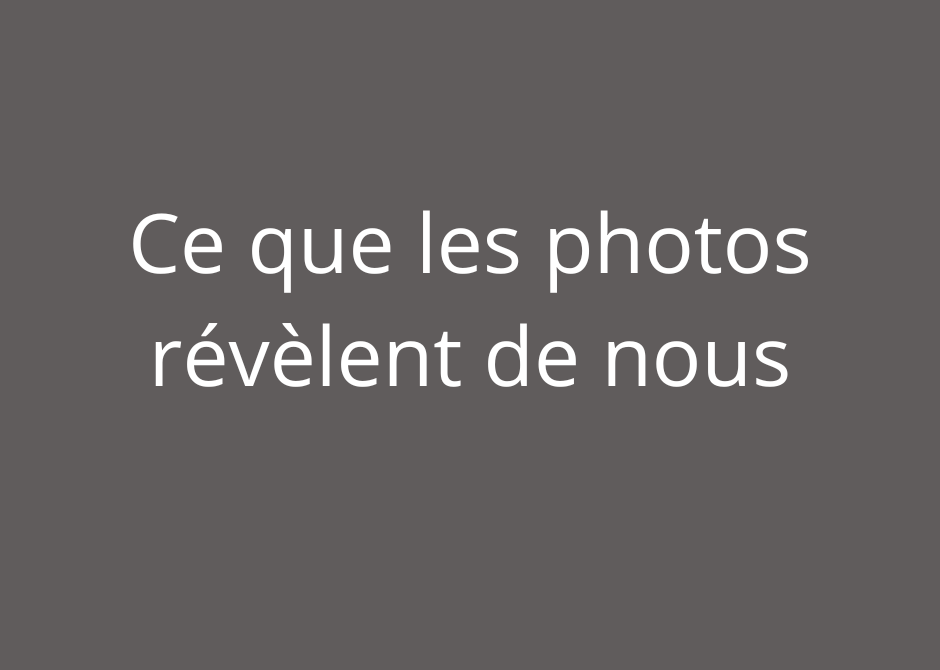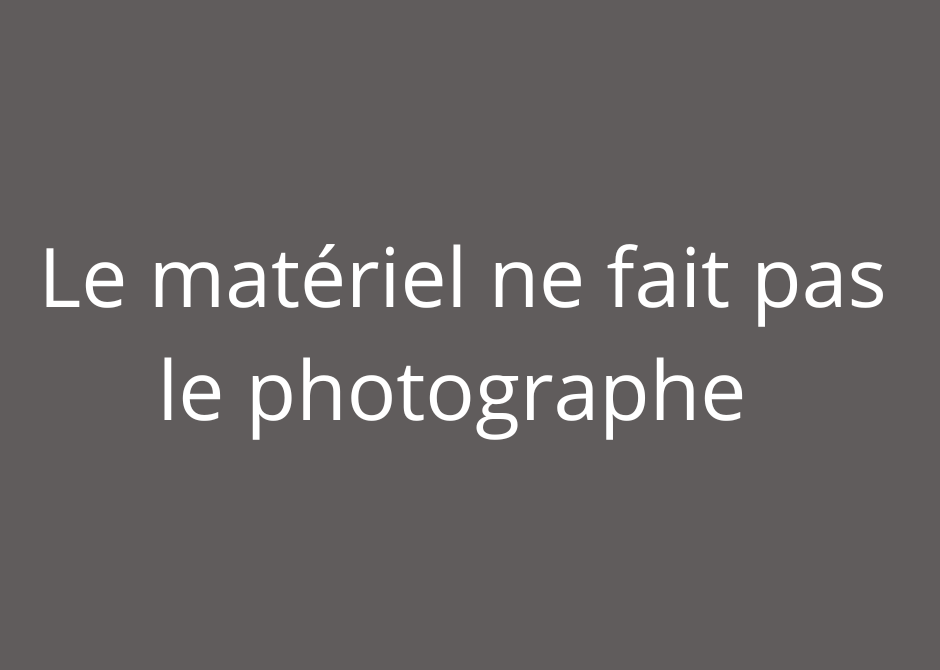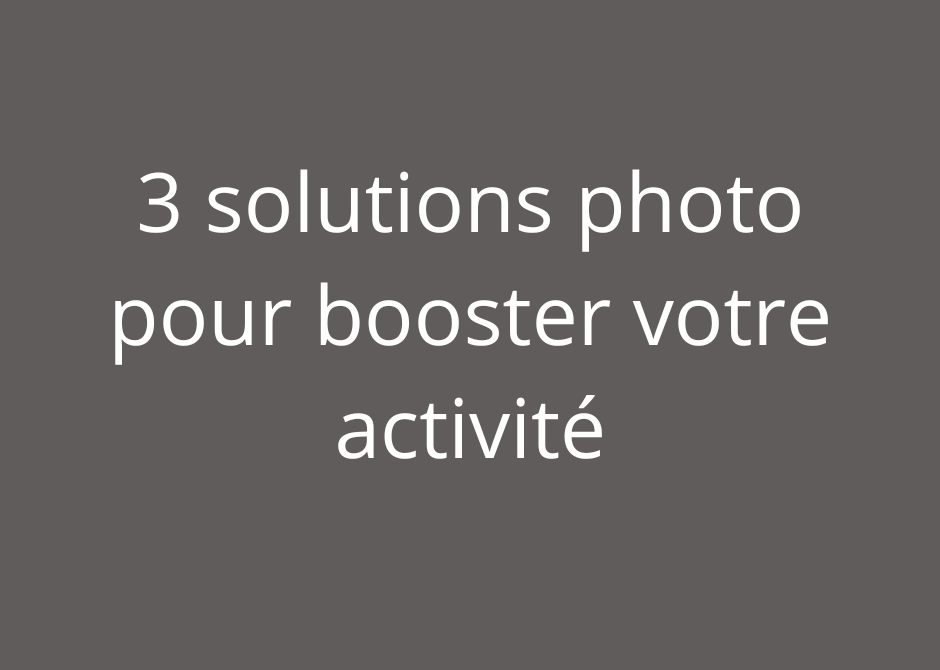Qui possède les photos ?
Quand on fait appel à un photographe professionnel, une question revient souvent :
“Les photos, elles sont à moi ou au photographe ?”
C’est une question légitime, mais la réponse n’est pas toujours celle qu’on imagine.
En France, le photographe reste toujours propriétaire de ses images — même quand il travaille pour un client.
En France, le photographe reste toujours propriétaire de ses images — même quand il travaille pour un client.
1. Le photographe est l’auteur, donc le propriétaire
Selon le Code de la propriété intellectuelle (article L111-1), le photographe est automatiquement titulaire des droits d’auteur sur ses images, dès leur création.
Cela veut dire :
- qu’il possède le droit moral (son nom doit être cité, et l’image ne peut pas être modifiée sans son accord),
- et le droit patrimonial (le droit d’autoriser ou non la reproduction, la diffusion, la vente ou l’usage commercial de ses photos).
En clair : même si vous payez une prestation photo, vous n’achetez pas les droits d’auteur, mais le droit d’utiliser les images selon les conditions convenues.
2. Les droits d’utilisation (ou de diffusion)
Lorsqu’un photographe livre des images, il accorde au client une licence d’utilisation.
Cette licence précise :
- les supports autorisés (site web, réseaux sociaux, presse, affichage, etc.),
- la durée (1 an, 5 ans, illimitée, etc.),
- le territoire (France, Europe, monde),
- et le contexte d’usage (commercial, institutionnel, personnel).
3. Peut-on acheter les droits complets d’une photo ?
Oui — il est possible d’acheter la totalité des droits sur une image.
On parle alors d’une cession complète des droits d’auteur.
On parle alors d’une cession complète des droits d’auteur.
Cela signifie que le photographe renonce à toute exploitation future de la photo (publication, vente, exposition, etc.), au profit exclusif de son client.
Mais cette cession totale a un coût élevé, car elle implique que le photographe perd toute source potentielle de revenus ou de valorisation artistique liée à ces images.
Elle est donc réservée à des usages très spécifiques :
- campagnes publicitaires nationales,
- visuels de marque déposée,
- communication institutionnelle à long terme.
De même, certains clients souhaitent obtenir les fichiers originaux (RAW).
C’est possible, mais là encore, cela représente une cession de valeur importante, car ces fichiers contiennent le travail brut du photographe, sa “matière première”.
Leur vente est donc exceptionnelle et facturée en conséquence.
C’est possible, mais là encore, cela représente une cession de valeur importante, car ces fichiers contiennent le travail brut du photographe, sa “matière première”.
Leur vente est donc exceptionnelle et facturée en conséquence.
En résumé : tout est possible, tant que c’est discuté, précisé et rémunéré à sa juste valeur.
4. Pourquoi cette distinction est importante?
Cette distinction protège à la fois le photographe et le client :
- Le photographe conserve la reconnaissance de son travail et peut valoriser son portfolio.
- Le client sait précisément ce qu’il peut (ou non) faire avec les images, sans risque juridique.
Le flou, c’est souvent là que naissent les malentendus : une photo réutilisée sans autorisation, recadrée ou retouchée sans mention, ou transmise à un tiers.
Un simple échange écrit ou une mention claire dans le devis suffit à tout cadrer.
Un simple échange écrit ou une mention claire dans le devis suffit à tout cadrer.
5. Et pour les photos de personnes ?
Autre point essentiel : même si le photographe détient le droit d’auteur, les personnes photographiées conservent leur “droit à l’image”.
Cela signifie qu’il faut leur accord pour diffuser une photo où elles sont reconnaissables, surtout dans un cadre commercial ou institutionnel.
En reportage, cet accord peut être :
- verbal, dans un cadre public ou événementiel (sauf contrat avec model release et/ou signalement de la présence d'un photographe)
- écrit, pour des portraits individuels ou une utilisation publicitaire.
Le model release collectif protège : (un article sera consacré au Model release)
le photographe, qui peut diffuser et livrer ses images sans risque juridique,
le client, qui sait que les droits à l’image sont couverts,
et les personnes photographiées, qui bénéficient d’une information claire et d’un usage respectueux de leur image.
En reportage, ce document est bien plus qu’une formalité : c’est une garantie de confiance et de transparence.
6. Le bon réflexe : la transparence
La meilleure manière d’éviter toute confusion, c’est d’en parler dès le début.
Le photographe explique les conditions de diffusion et les droits cédés dans son devis ou contrat.
Le client, lui, peut demander une extension de droits selon ses besoins (par exemple, pour une campagne, un catalogue, une expo, etc.).
Le photographe explique les conditions de diffusion et les droits cédés dans son devis ou contrat.
Le client, lui, peut demander une extension de droits selon ses besoins (par exemple, pour une campagne, un catalogue, une expo, etc.).
Une relation claire dès le départ, c’est un gage de confiance et de respect mutuel.
En résumé
Le photographe reste l’auteur et le propriétaire légal de ses images.
Le client achète un droit d’utilisation, défini par contrat.
Et c’est cette complémentarité qui garantit à la fois la valeur artistique du travail et la sécurité juridique de tous.
Acheter des photos, ce n’est pas acheter le fichier :
c’est investir dans un regard, une création, une histoire.
c’est investir dans un regard, une création, une histoire.